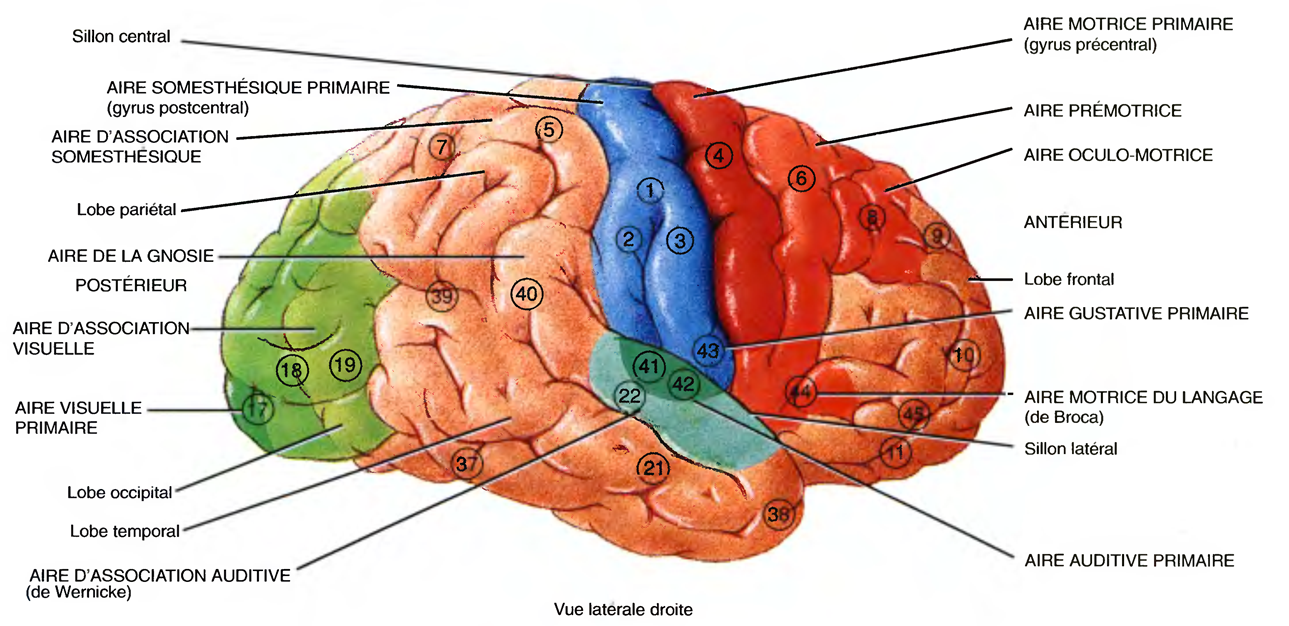Je lis. Beaucoup, pas beaucoup ? Jamais assez quand je suis avec des intellectuels, toujours trop quand je suis avec des gens simples, qui peut-être ne se prennent pas autant la tête.
J’ai mal à la tête. A chaque fois que je lis de la théorie philosophique et politique, que je tire de nouvelles analyses d’un essai, d’une étude ou d’un roman. C’est comme une enclume dans le crâne, la sensation d’un estomac après un trop gros repas. Comme si je n’avais déjà plus de place dans ma tête, que tout ce que j’y ajoutais faisait déborder un bol d’acide qui me ferait souffrir.
Avant, quand je n’y prenais pas garde, que je dévorais bouquin sur bouquin, ça me prenait plus fortement encore. Je ne remarquais pas les signes annonciateurs, je me plongeais dans ce nouveau bain d’idées, et je me trouvais comme hydrocuté·e, paralysé·e. Brain-freeze, comme quand on mange une glace trop vite. Et pendant des jours, alors que souvent ces lectures venant d’une volonté de me rendre plus précis dans mes actions, plus stratège, je ne pouvais plus rien faire. Immobile mentalement, en train de me laisser à nouveau couler dans le quotidien. Maintenant, j’y prête attention, j’y vais prudemment et je m’arrête quand je sens mes neurones s’enflammer. Mais j’en suis tout autant frustré·e.
A la fac, ce n’était pas mieux. On n’apprenait pas à réfléchir, pas à gérer l’infini du savoir. Au contraire, on nous ouvrait les portes de milles domaines, milles concepts, milles voies, en nous faisant bien comprendre que tout restait à réfléchir. Et pire, on devait travailler, se casser la tête sur des choses pour lesquelles on avait aucun intérêt. A questionner les milles pourquoi de la théologie, à rejouer les débats antiques, à s’interroger sur ce que représente le geste artistique… Sans interroger les conditions du cadre dans lequel nous existions présentement bien sûr ! Certain·es s’adaptaient bien sûr, devenant des robots universitaires, pondant des thèses comme une machine fabriquerait des pneus, en respectant bien le moule, sans conscience. Ruine de l’âme.
D’autres comme moi souffrent de maux de crâne. Sûrement parce que nous apportons une valeur autre à ce que nous pensons, à l’impact concret que cela va avoir dans nos actions (encore faut-il agir) et sur le monde qui nous entoure. Et si désormais je ne redoute plus le doute, mais l’accepte comme élément non pas d’obstruction mais d’évolution ; je le brandirais même comme nécessité à la réelle démocratie et la vie en société ; il en reste que ce mal de tête persiste.
Le monde est si vaste, l’existence si infinie et nos vies si courtes. Comment savoir quoi faire ? Comment comprendre les choses sous un bon axe, savoir y réagir correctement ? Comment prendre le temps d’analyser sans le perdre à ne pas acter ? Faut-il lire encore, discuter plutôt, se mettre en marche prudemment ou courir tête baissée ? Regarder sur les côtés, droit devant ou en arrière ? Chercher des alternatives, un avenir ou fuir le passé ? Faut-il étudier la sociologie, la politique ou l’histoire ? Faut-il tout abandonner et tout miser sur un autre mode de vie ? Qui a raison, entre Judith Butler ou Ted Kaczynski ? Faut-il ouvrir une nouvelle voie entre deux ? Est-ce que Baedan le fait vraiment ? Faut-il écouter des mecs morts ou presque, l’avant-garde de notre génération ou mes proches ? Quelle parole a plus d’importance entre le grand Foucault et un poivrot dans un bar ? Entre Marx et un mec sur Twitter qui s’en réclame ? Comment lier théorie et actualité, observation et mise en pratique ? Faut-il fonder un parti, écrire une chanson, organiser une cantine ou poser une bombe ?
Je ne sais pas. Mais migraine ou pas, il ne faut pas oublier d’avancer. Ne pas rester statique au milieu de l’océan.
Destro